Avis d'expertes sur le rôle du fédéralisme
Le fédéralisme a-t-il plutôt été un frein ou un accélérateur à la participation des femmes à la vie politique en Suisse ?
«L'introduction du droit de vote des femmes au niveau cantonale a effectivement influencé le résultat de la votation fédérale de 1971»
Il n’est probablement pas possible de répondre clairement par oui ou par non à cette question. Comme pour beaucoup d’autres interrogations, le fédéralisme a apporté des réponses nuancées à replacer dans le contexte de l’époque. Dans tous les cas, le suffrage féminin mis en place dans certains cantons avant son introduction au niveau fédéral a montré que les arguments (généralement peu convaincants) contre le droit de vote des femmes étaient dénués de fondement. À cet égard, la possibilité pour les cantons d’introduire le suffrage féminin de manière autonome et indépendamment de la situation à l’échelon fédéral pourrait bien avoir joué un rôle dans l’issue du scrutin de 1971. Généralement, lorsque l’on parle des droits politiques, on constate que les solutions expérimentées dans les cantons font bouger les lignes au niveau fédéral (comme on le voit avec le droit de vote des étrangers).

À propos de l'auteure
Astrid Epiney est professeure en droit international, droit européen et droit public suisse à l’Université de Fribourg et directrice exécutive de l’Institut de droit européen.
«Les questions égalitaires relèvent souvent de la compétence des cantons»
Le fédéralisme et ses outils ont plutôt ralenti la progression vers l’égalité des genres. Cette réalité s’explique notamment par le poids accordé aux petits cantons catholiques, dans lesquels les valeurs conservatrices sont encore bien ancrées. La votation de 2013 sur l’article relatif à la politique de la famille en est la parfaite illustration : la majorité des cantons l’a emporté sur la majorité du peuple, empêchant ainsi que les cantons soient obligés de créer une offre adaptée de places d’accueil extra-familial et extra-scolaire.
Ces dernières décennies, le Conseil des États, plus réticent au changement que le Conseil national, a freiné certaines avancées en matière d’égalité des sexes. Dans les années 1980, lors des débats sur la réforme du droit matrimonial, il s’est par exemple opposé avec succès au droit pour la femme de conserver son nom de jeune fille si elle en fait la demande.
À cela s’ajoute que les questions égalitaires touchent souvent des domaines tels que la formation et l’éducation, pour lesquels la Confédération n’a aucune compétence de réglementation. Ainsi, la Conférence des directeurs cantonaux de l’instruction publique a émis en 1972 déjà des recommandations pour instaurer l’équité entre homme et femme dans le système éducatif. Or, en 1991, seule une petite moitié des cantons avait supprimé toutes les inégalités formelles.
À l’inverse, la Confédération a parfois freiné les cantons désireux d’innover, notamment en leur déniant la compétence d’engager certaines mesures. Au début des années 1980, par exemple, elle a rejeté la possibilité d’introduire l’interruption de grossesse non punissable. Et il y a quelques semaines à peine, le Conseil des États a refusé d’accorder aux cantons la compétence de mettre en place un congé parental.
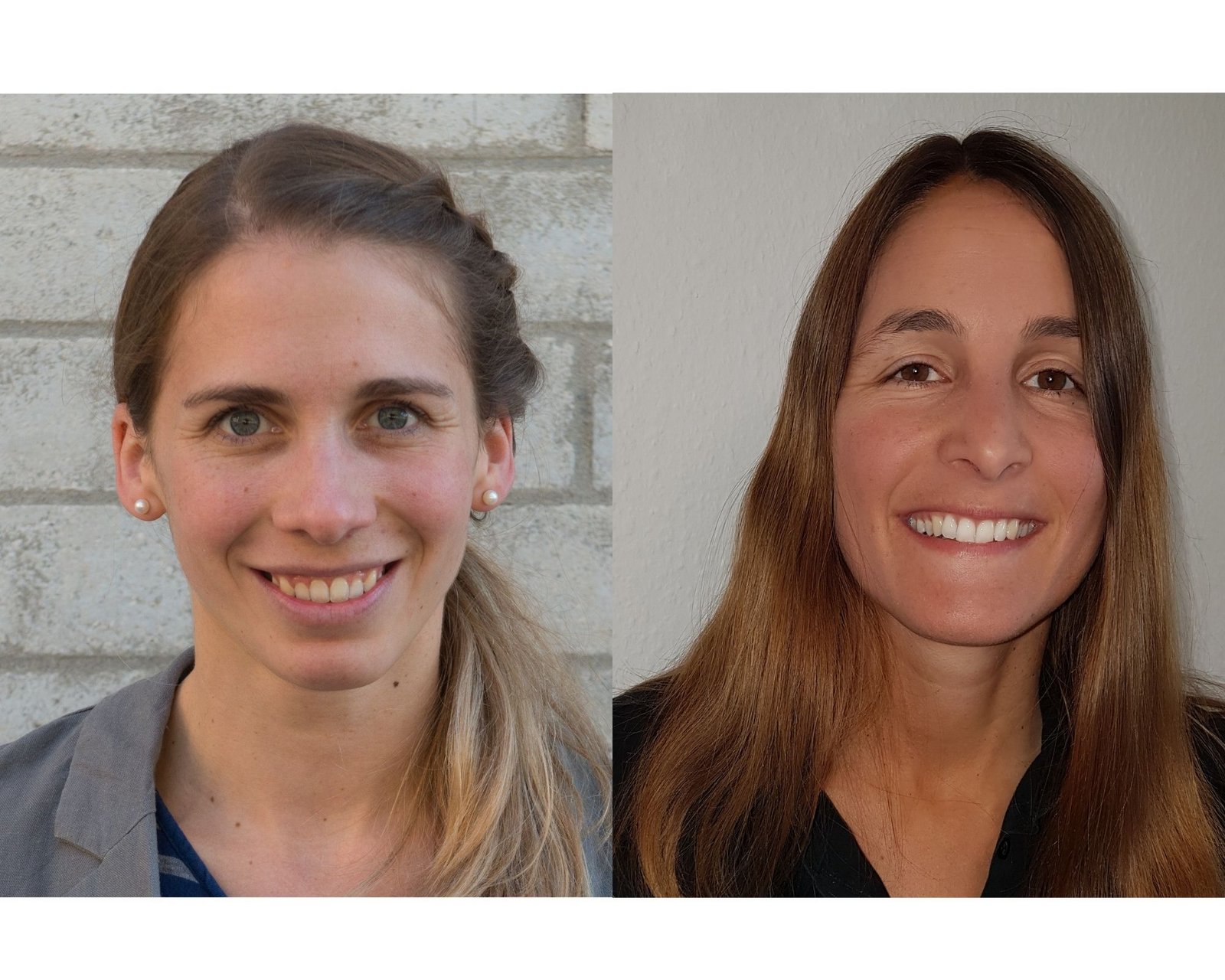
À propos des auteures
Marlène Gerber et Anja Heidelberger sont les codirectrices d’« Année Politique Suisse », une chronique dédiée à la politique suisse de l’Institut de sciences politiques de l’Université de Berne. Dans le recueil « Dem Laufgitter entkommen: Frauenforderungen im Parlament seit 1950 », paru en allemand, elles retracent l’évolution de la politique d’égalité des sexes en Suisse.
«Le fédéralisme a été un frein»
Le fédéralisme a essentiellement été un frein à l’introduction du droit de vote des femmes en Suisse.
Il a tout d’abord ralenti les développements au niveau fédéral. Le Conseil fédéral et le Parlement ont très souvent invoqué les scrutins cantonaux à venir, qu’il fallait attendre. Et si les résultats étaient négatifs, ils s’en servaient pour ne pas agir au niveau fédéral.
Ensuite, les opposants ont utilisé à plusieurs reprises le fédéralisme pour renvoyer la question de l’introduction du suffrage féminin à l’autre échelon institutionnel et ainsi la reporter.
Puis, le fédéralisme a donné un poids disproportionné aux cantons catholiques et ruraux à faible densité de population, qui étaient plutôt contre le droit de vote des femmes.
Pour finir, le respect de l’autonomie cantonale et communale a empêché les autorités fédérales de rendre le suffrage féminin obligatoire à tous les échelons institutionnels en 1971. Ainsi, l’égalité politique des femmes suisses a été retardée de près de deux décennies.
Cependant, le fédéralisme a eu un rôle d’accélérateur à deux égards :
En 1959, le canton de Vaud a profité de la première votation fédérale pour soumettre un objet cantonal afin de préserver, selon l’argumentation, l’organisation fédérale « de bas en haut ».
En outre, l’exemple des cantons pionniers a permis de montrer que l’introduction du suffrage féminin n’avait conduit à aucune des catastrophes annoncées.

À propos de l'auteure
Pr. Dr. Brigitte Studer est professeure émérite d’histoire contemporaine suisse et générale à l’Institut d'histoire de l'Université de Berne et auteure du livre « La conquête d’un droit. Le suffrage féminin en Suisse ».
